Les nouvelles jurisprudences

Est-ce qu’un salarié, malgré l’absence de documents contractuels, doit restituer sa ligne téléphonique exclusivement professionnelle après la rupture de son contrat ?
Oui !
À la suite du licenciement d’un salarié, l’employeur lui a demandé de restituer l’ensemble des documents et matériels lui appartenant, dont un téléphone portable.
Le salarié a toutefois conservé la ligne téléphonique professionnelle (et donc la carte SIM) en la transférant à son nom. L’employeur a saisi la formation en référé du conseil de prud’hommes pour en obtenir la restitution.
La Cour de cassation, saisie du litige, répond à la question – inédite – de savoir si un salarié peut conserver la ligne téléphonique mise à sa disposition par l’employeur pendant l’exécution de son contrat de travail.
Pour la cour d’appel, il ne résultait ni du contrat de travail du salarié ni d’aucun document contractuel que cette ligne téléphonique pouvait être utilisée par le salarié tant à titre professionnel qu’à titre personnel, aucun usage ni aucune tolérance à ce titre n’étant par ailleurs démontrés. Il ne ressortait pas non plus d’un document quelconque que la mise à disposition de cette ligne téléphonique constituait un avantage pour le salarié.
En outre, la ligne avait été souscrite par l’employeur, qui en avait payé les factures jusqu’à son transfert au salarié. Le numéro de téléphone associé à la ligne n’avait donc jamais été une ligne personnelle du salarié.
Enfin, le salarié n’apportait pas la preuve d’un accord conclu avec l’employeur pour qu’il conserve la ligne après la rupture de son contrat de travail.
La cour d’appel en déduit que la ligne téléphonique correspondant au numéro du téléphone portable mis à la disposition du salarié pendant l’exécution de son contrat de travail est la propriété de l’entreprise.
La chambre sociale de la Cour de cassation approuve la décision d’appel. Après avoir rappelé qu’en application de l’article R 1455-7 du Code du travail, une formation de référé peut ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire dans le cas où son existence n’est pas sérieusement contestable, la chambre sociale juge que la cour d’appel a pu, sans excéder ses pouvoirs, ordonner la restitution de la ligne téléphonique après avoir constaté son caractère professionnel.
L’enjeu était certainement important pour l’employeur, compte tenu des fonctions de responsable commercial exercées par le salarié. Conserver sa ligne téléphonique, c’était conserver un contact avec ses anciens clients, ce qui présentait un risque concurrentiel pour l’ancien employeur.
Après la rupture du contrat de travail, le salarié doit en principe remettre à son employeur les accessoires à son contrat de travail. Tel est le cas notamment du véhicule de fonction, des vêtements de travail, des téléphones portables et ordinateurs professionnels.
Par exception, certains accessoires peuvent toutefois être conservés par le salarié. Ainsi, les agendas professionnels, qui constituent des documents personnels de travail pour le salarié et qui peuvent contenir parfois des notes personnelles, ne peuvent être réclamés par l’employeur à l’issue du contrat de travail.
La solution retenue, ici, par la cour d’appel et la Cour de cassation aurait pu être différente si l’employeur avait autorisé le salarié à utiliser la ligne téléphonique à des fins personnelles. Dans cette situation, en effet, l’employeur n’aurait pas été le propriétaire exclusif de la ligne.
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2025 : https://urls.fr/aEDbQZ
Absence injustifiée : l’articulation entre le licenciement pour faute et la présomption de démission
Lorsqu’un salarié quitte son poste ou ne se présente pas à son travail sans justifier cette absence, on peut parler d’abandon de poste ou d’absence injustifiée.
Dans cette situation, le salarié est en faute et son licenciement peut se justifier. Mais la faute grave n’est pas automatique.
C’est ce que nous indique la Cour de cassation dans une affaire où le salarié ne s’est pas présenté au travail pendant une période d’activité intense de l’entreprise, sans à aucun moment justifier de son absence, et ce, malgré une mise en demeure de son employeur au bout d’une dizaine de jours. L’employeur a considéré que cette absence injustifiée constituait une faute grave.
Mais les juges n’ont pas suivi. En l’espèce, le salarié avait 22 ans d’ancienneté sans antécédent disciplinaire. Il avait demandé des congés en plus pour assister sa mère âgée, malade qui venait de perdre son époux, puis s’était d’autorité placé en congés sans solde malgré la période d’intense activité pour l’entreprise.
Les juges en ont déduit qu’il y avait bien absence injustifiée. Mais au regard du contexte, les faits ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise.
Les faits sont antérieurs à la mise en place du nouveau dispositif de la présomption de démission mais on peut se demander comment appréhender la situation maintenant que la présomption de démission existe.
Depuis le 19 avril 2023, la présomption de démission a été mise en place quand le salarié abandonne son poste sans justification. Lorsque l’employeur constate que le salarié a abandonné son poste et « entend » faire valoir la présomption de démission, il le met en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours[1].
Ce dispositif, destiné à contrecarrer l’indemnisation par l’Assurance chômage des salariés abandonnant volontairement leur poste et licenciés de ce fait, continue encore aujourd’hui de soulever de nombreuses questions.
La principale c’est de savoir si face à un salarié absent on peut continuer de préférer passer par un licenciement pour faute ou s’il faut utiliser la démission présumée.
Il s’avère que vous avez le choix de la procédure car, malgré les premières indications données par le ministère du Travail, il n’est mentionné nulle part :
- que vous avez l’obligation de recourir à la démission présumée ;
- que cette possibilité exclut désormais tout recours au licenciement pour absence injustifiée.
Le ministère du Travail attend désormais l’avis du Conseil d’Etat sur ce sujet. La décision présente garde donc tout son intérêt si vous envisagez un licenciement pour faute.
L’autre question est de savoir si, dans les faits présents, l’employeur aurait véritablement pu utiliser la présomption de démission jusqu’au bout. Car dans le cadre de cette procédure le salarié qui justifie son absence dans le délai requis (fixé par l’employeur mais pas moins de 15 jours) doit reprendre son poste.
Le Code du travail donne une liste de motifs légitimes :
- des raisons médicales ;
- l’exercice du droit de retrait ;
- l’exercice du droit de grève ;
- le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ;
- la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur[2].
Mais il faut savoir que cette liste n’est pas exhaustive. L’accompagnement d’un proche malade et isolé pourrait donc parfaitement tenir lieu de justification.
Dès lors que le motif est légitime, la procédure doit donc être abandonnée. Dans une situation similaire, il semble donc compliqué de mener à terme la procédure. De plus, si le salarié reprend le travail après un abandon de poste dans les délais requis (y compris s’il le fait à plusieurs reprises), vous ne pourrez pas utiliser la présomption de démission et la procédure disciplinaire sera la seule voie possible.
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 : https://urls.fr/BYNyJs
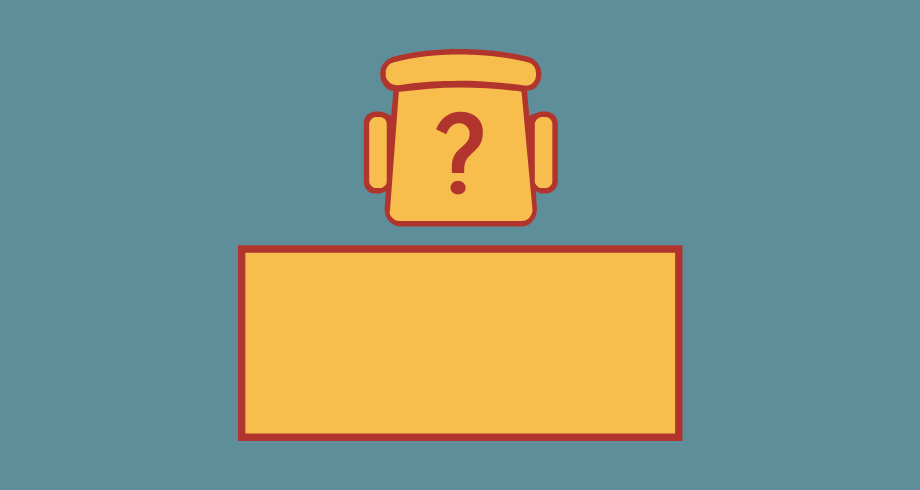
Est-ce que des témoignages anonymes, non étayés par d’autres éléments, peuvent être recevables devant les tribunaux comme preuve du caractère réel et sérieux d’un licenciement ?
Oui !
Licencié pour faute grave, un salarié saisit la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.
La CEDH juge que le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes, étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de procès équitable au sens de l’article 6 § 1, de la Convention. Ils exigent un juste équilibre entre les parties. Chacune des parties doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation d’important désavantage par rapport à son ou ses adversaires.
Cependant, le droit à la divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu, en présence d’intérêts concurrents tels que, notamment, la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles, qui doivent être mis en balance avec les droits du justiciable.
Par conséquent, le juge doit procéder à un examen au regard de la procédure considérée dans son ensemble et de rechercher si les limitations aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes ont été suffisamment compensées par d’autres garanties procédurales.
Il en résulte que si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
En l’absence de tels éléments, il appartient au juge d’apprécier si la production d’un témoignage dont l’identité de son auteur n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d’égalité des armes et les droits du requérant. Le droit à la preuve permet de justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Pour juger le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur, l’arrêt d’appel indique que, la société, pour caractériser la faute du salarié, produit uniquement deux constats d’audition aux fins de preuve établis par huissier de justice, reprenant les contenus des auditions effectuées par cet huissier de cinq témoins dont l’identité n’est jamais mentionnée, à la demande de ces personnes.
Selon la Cour d’appel, les témoignages anonymisés, en application de l’article 16 du Code de procédure civile et de l’article 6 § 1 et 3, de la CEDH doivent être déclarés « non probants », de sorte que l’existence d’une faute grave n’est pas démontrée.
Pour casser la décision d’appel, la Cour de cassation retient que les témoignages anonymisés avaient été portés à la connaissance du salarié et que ces témoignages avaient été recueillis par un huissier de justice responsable de la rédaction de ses actes pour les indications matérielles qu’il a pu lui-même vérifier et qu’il n’est pas contesté que le salarié avait déjà été affecté à une équipe de nuit pour un comportement similaire à celui reproché dans la lettre de licenciement.
La production de ces témoignages anonymisés était donc indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et que l’atteinte portée au principe d’égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi.
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2025 : https://urls.fr/aEmGVl
Inaptitude d’un salarié : consultation obligatoire du CSE même en cas d’impossibilité de le reclasser
La mise en œuvre de l’obligation de reclassement lorsqu’un salarié est déclaré inapte par la médecin du travail peut parfois se solder par l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié. Mais attention, cette circonstance ne vous dispense aucunement de recueillir l’avis de votre CSE avant d’engager une procédure de licenciement. A défaut, vous manquerez à votre obligation de reclassement et priverez le licenciement notifié de cause réelle et sérieuse.
En tant qu’employeur, vous pouvez envisager de licencier un salarié inapte uniquement lorsque vous vous trouvez dans l’une de ces situations :
- expressément dispensé, par le médecin du travail, de l’obligation de reclasser le salarié ;
- impossibilité de procéder au reclassement du salarié ;
- refus, par le salarié, de votre ou de vos offres de reclassement.
Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, un recours à la rupture conventionnelle peut être également envisagé[1].
L’obligation de reclassement vous impose de proposer au salarié un autre emploi :
- approprié à ses capacités ;
- aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de certaines mesures (ex : aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail) ;
- disponible au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant.
De même, il vous revient, afin de soumettre une offre de reclassement avec sérieux et loyauté, de prendre en considération les conclusions écrites du médecin du travail ainsi que l’avis émis par votre comité social et économique (CSE). C’est à la condition, bien entendu, qu’une telle instance soit instituée au sein de votre entreprise.
La consultation du comité doit être menée à un moment bien précis. C’est-à-dire entre la déclaration d’inaptitude du salarié et la transmission d’une proposition de reclassement à ce dernier.
A défaut de consultation, ou en cas de consultation irrégulière, vous manquerez à votre obligation de reclassement et priverez, conséquemment, votre mesure de licenciement de cause réelle et sérieuse.
Si l’entreprise dispose d’établissements distincts, vous devrez recueillir l’avis du CSE de l’établissement dans lequel travaille le salarié.
Mais qu’en est-il si vous constatez, faute de poste disponible, que vous êtes dans l’impossibilité de reclasser un salarié inapte ? Cette circonstance vous autorise-t-elle à engager une procédure de licenciement sans consulter au préalable le CSE ?
Ces questionnements conduisent régulièrement la Cour de cassation à rappeler sa position qui est que cette situation ne vous libère pas de cette formalité consultative.
Dès lors que vous n’êtes pas expressément exempté de votre obligation de reclassement et qu’un CSE est établi dans l’entreprise, vous devez procéder à une consultation de l’instance. Et ce, même si vous savez que vous n’êtes pas en mesure de proposer un poste de reclassement au salarié.
Dans cette situation, l’avis du comité doit être sollicité entre la déclaration d’inaptitude du salarié et sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Ces solutions, solidement établies en jurisprudence, ont été rappelées par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2025.
Dans la présente affaire, un employeur n’était pas en capacité de proposer à un salarié inapte un poste de reclassement n’impliquant aucune mobilité géographique. Ce qui, en l’occurrence, contrevenait au souhait que ce dernier avait formulé dans les jours suivant la reconnaissance de son inaptitude.
Estimant que la consultation des représentants du personnel avait été réalisée de manière irrégulière, principalement en raison de sa tardiveté, le salarié avait saisi le juge prud’homal.
En appel, les juges avaient considéré que l’impossibilité, pour l’employeur, de soumettre une offre de reclassement conforme au vœu du salarié l’exemptait de toute consultation des représentants du personnel.
Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation.
Il reste dorénavant à déterminer si la tardiveté de cette consultation rendait effectivement le licenciement irrégulier.
Attention ! Cette décision ne s’applique pas aux cas de dispenses de la recherche de reclassement prononcées par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude. En effet, il existe un seul cas dans lequel l’employeur n’est pas tenu de consulter le CSE, c’est lorsque le médecin du travail a rendu un avis mentionnant expressément que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2025 : https://urls.fr/k2PZYM
[1] Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767

L’arrêté du 19 mars 2025 fixant pour 2025 le montant du versement santé publié
Certains salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion à la couverture obligatoire de santé. En contrepartie, ils ont droit à une aide financière patronale. Cette aide individuelle est calculée en fonction d’un montant de référence auquel on applique un coefficient. Les valeurs applicables pour l’année 2025 ont été publiées au Journal officiel le 25 mars.
Le « versement santé » est une aide mise en place lors de la généralisation de la couverture santé. Elle est versée aux salariés qui, sous certaines conditions, peuvent demander une dispense d’adhésion à la couverture complémentaire santé collective et obligatoire.
Par exemple, les salariés en contrat de travail à durée déterminée (ou en contrat de mission) dont la durée de la couverture collective obligatoire santé ou du contrat est inférieure à 3 mois peuvent bénéficier d’une dispense de droit d’adhésion. Mais ils doivent justifier d’une couverture santé individuelle « responsable ».
Dans le cadre de cette dispense d’adhésion, ils ont droit à une aide financière patronale afin de financer leur complémentaire santé individuelle.
Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement en fonction d’un montant de référence auquel est appliqué un coefficient.
Ce montant de référence correspond à votre contribution mensuelle au financement de la couverture collective de la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée. Elle tient compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié.
Le coefficient appliqué au montant de référence est de :
- 105 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ;
- 125 % pour les salariés bénéficiant d’un CDD ou d’un contrat de mission.
Si votre contribution patronale est pour toute ou partie forfaitaire et indépendante de la durée effective de travail, vous appliquez le coefficient à la partie forfaitaire.
Si le montant de la contribution ne peut pas être déterminé pour la catégorie du salarié, le montant de référence est fixé par voie réglementaire.
Le montant de référence est fixé par arrêté. Pour l’année 2025, ce montant de référence servant au calcul du « versement santé » est fixé à 21,50 euros. Ce montant était de 20,75 euros pour l’année 2024.
Pour les personnes relevant du régime local d’Alsace-Moselle, le montant de référence est fixé à 7,18 euros pour l’année 2025. Il était de 6,93 euros en 2024.
Consulter l’arrêté du 19 mars 2025 fixant pour 2025 le montant du versement mentionné à l’article L. 911-7-1 du code de la Sécurité sociale : https://urls.fr/sdFcXX
