Jurisprudences
Toutes les semaines, retrouvez les nouvelles jurisprudences
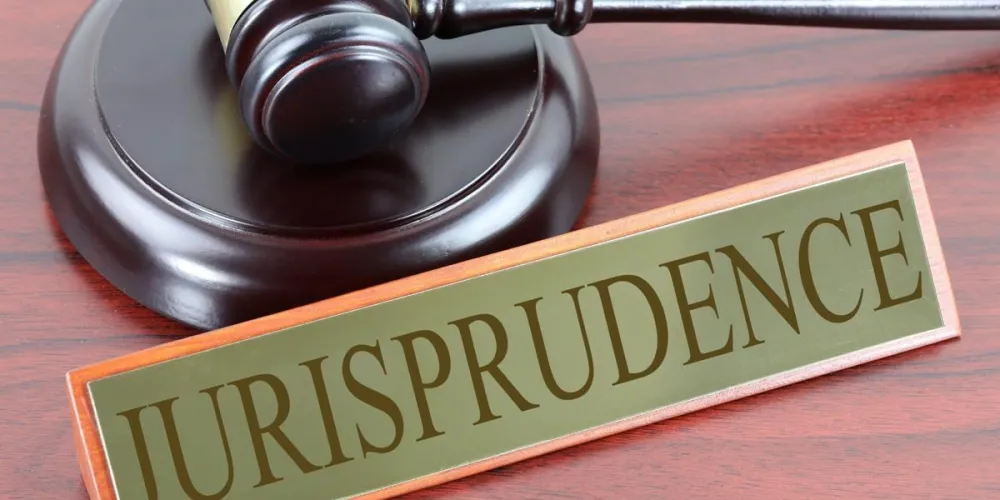
Les possibilités juridiques pour aider les entreprises à surmonter leurs difficultés financières (les procédures collectives)
Lorsqu'une entreprise traverse des difficultés financières, plusieurs mesures judiciaires existent pour l'aider à surmonter ces obstacles. Les procédures collectives visent à assurer la continuité de l'activité, préserver l'emploi et protéger les créanciers.
Ces dispositifs sont essentiels pour préserver le tissu économique, maintenir les relations avec les fournisseurs et clients, et sauvegarder les emplois créés par l’entreprise.
Qu’est-ce qu’une procédure collective ?
Une procédure collective est un mécanisme juridique destiné aux entreprises confrontées à des difficultés financières. Elle est encadrée par la loi et implique une gestion collective des créanciers sous la supervision d’un mandataire judiciaire ou d’un liquidateur nommé par le tribunal.
Ses objectifs principaux :
- Aider l’entreprise à se redresser et régler ses dettes ;
- Si le redressement est impossible, organiser la liquidation pour rembourser les créanciers autant que possible.
Toutes les entreprises, y compris les entreprises individuelles, sont éligibles.
Les différentes procédures collectives
Selon la gravité des difficultés financières, trois types de procédures existent :
La sauvegarde judiciaire[1] (jusqu’à 18 mois)
Elle est destinée aux entreprises qui rencontrent des difficultés sérieuses mais qui ne sont pas encore en cessation des paiements. Elle permet la réorganisation de l’entreprise et l’apurement des dettes.
[1] Articles L620-1 et suivants du code de commerce
Le redressement judiciaire[2] (jusqu’à 18 mois)
Elle est destinée aux entreprises qui ne peuvent plus payer leurs dettes mais dont le redressement est encore envisageable. Elle a pour objectif la poursuite d’activité, la sauvegarde des emplois et l’apurement des dettes.
[2] Articles L631-1 et suivants du code de commerce
Liquidation judiciaire[3] (arrêt immédiat de l’activité)
Elle est destinée aux entreprises en cessation des paiements et que tout redressement est impossible. Elle entraîne la fermeture de l’entreprise, licenciement des salariés et vente des actifs pour rembourser les créanciers.
[3]Articles L640-1 et suivants du code de commerce
Attention, lors de la première audience, le juge peut décider de convertir une demande de redressement en liquidation s’il considère que l’entreprise est irrécupérable financièrement.
Les conditions d’ouverture d’une procédure collective
Les critères varient selon la procédure demandée :
La sauvegarde judiciaire :
- L’entreprise rencontre des difficultés sérieuses ;
- Elle n’est pas en état de cessation des paiements ;
- La demande peut être faite par le dirigeant uniquement.
Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsque son “actif disponible” n’est pas suffisant pour faire face au “passif exigible”. Concrètement, il s’agit du moment où l’entreprise n’a plus assez d’argent disponible immédiatement pour payer les dettes arrivées à échéance. La date de cessation des paiements peut être déterminée à l’avance, à l’aide des indicateurs de pilotage de votre entreprise. Plus ce risque est détecté tôt, plus il sera simple de parer à cette difficulté.
Redressement judiciaire :
- L’entreprise est en cessation des paiements ;
- La situation financière n’est pas irrémédiablement compromise ;
- Peut être demandée par le dirigeant, un créancier ou le ministère public ;
- L’ouverture du redressement judiciaire doit être demandée dans les 45 jours suivants le passage en état de cessation des paiements.
Liquidation judiciaire :
- L’entreprise est en cessation des paiements ;
- Aucune perspective de redressement financier possible ;
- Peut être demandée par le dirigeant, un créancier ou le ministère public.
En cas de liquidation, un liquidateur judiciaire est nommé pour vendre les actifs et rembourser les dettes.
Conséquences de l’ouverture d’une procédure collective
Une fois la procédure collective ouverte, plusieurs mesures s’appliquent :
- Le gel des poursuites individuelles : Les créanciers ne peuvent plus exiger le remboursement immédiat de leurs créances.
- Le gel des paiements des dettes antérieures : L’entreprise ne peut plus régler ses dettes antérieures tant que la procédure est en cours.
- Interdiction d’ouvrir une procédure préventive (conciliation, mandat ad hoc).
Attention, le délai qui s’est écoulé entre la date de cessation des paiements et la date d’ouverture de la procédure collective s’appelle la période suspecte. Le juge peut remettre en cause les actes de gestion pris durant cette période s’il estime qu’ils ont aggravé le passif ou si le dirigeant a commis une faute de gestion.
Evaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général
L’arrêté du 25 février 2025 procède à la révision de l’évaluation forfaitaire des avantages en nature véhicule pour les véhicules thermiques mis à disposition à compter du 1er février 2025.
Il reconduit également jusqu’au 31 décembre 2027 la tolérance applicable depuis le 1 er janvier 2020 à l’évaluation de l’avantage en nature pour les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique en l’adaptant pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025.
L’application rétroactive au 1er février de cet arrêté ne tient pas compte des impératifs des entreprises. En effet, cela conduira certaines d’entre elles à recalculer des fiches de paie et à régulariser des cotisations sur des périodes déjà clôturées.
1. Pour les véhicules thermiques
L’évaluation sur la base des dépenses réelles comprend :
- Lorsque le véhicule est acheté, l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 %.
- Lorsque le véhicule est loué ou loué avec option d’achat, le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
L’évaluation sur la base d’un forfait annuel est réalisée de la manière suivante :
a. Pour les véhicules mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025
Pour les véhicules dont la date de mise à disposition est antérieure au 1er février 2025, l’avantage en nature reste évalué selon les anciennes règles jusqu’à la fin de la mise à disposition du véhicule
- Lorsque le véhicule est acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat.
o Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans. - Lorsque le véhicule est loué, le cas échéant avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule.
o Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
b. Pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025 Augmentation de l’évaluation forfaitaire des avantages en nature :
- Lorsque le véhicule est acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 15 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 10 % du coût d’achat.
o Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 20 % du coût d’achat du véhicule et de 15 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans. - Lorsque le véhicule est loué, le cas échéant avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 50 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule.
o Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 67 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
2. Pour les véhicules électriques
Pour les véhicules dont la date de mise à disposition est antérieure au 1er février 2025, la tolérance initiale reste applicable jusqu’à la fin de la mise à disposition du véhicule.
- L’évaluation forfaitaire ne tient pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et est calculée après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 2 000,30 euros par an.
Pour les véhicules mis à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027 fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique et obtenant un score environnemental supérieur au score minimal requis :
- est ajouté un critère d’éco-score pour bénéficier de la tolérance ;
- l’abattement passe de 50 à 70% dans la limite de 4 582 euros (au lieu de 2 000,30 euros en janvier 2025) par an ;
- l’évaluation forfaitaire ne tient pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et est calculée après application d’un abattement de 70 % dans la limite de 4 582 euros par an.
3. Avantage en nature des bornes de recharge électrique
L’arrêté prolonge jusqu’au 31 décembre 2027, sans la modifier, la tolérance applicable à l’évaluation de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition par l’employeur d’une borne de recharge électrique ou de la prise en charge de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation de celle-ci qui devait prendre fin au 31 décembre 2024.
Lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, l’avantage en nature résultant de l’utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d’un montant nul, y compris pour les frais d’électricité.
Lorsque la borne est installée en-dehors du lieu de travail :
- En cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge :
o Lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales ;
o Lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 000 euros.
Ces limites sont portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 500 euros respectivement lorsque la borne a plus de cinq ans.
- En cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité), cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.
Consulter l’arrêté du 25 février 2025 : https://urls.fr/iru_kc
Consulter le BOSS applicable à l’arrêté (mis à jour le 12/03/2025) : https://urls.fr/oaz7cZ
Est-ce qu’une clause de déplacement occasionnel peut s’imposer au salarié dont l’activité implique d’être mobile ?
Oui !
Pour rappel, une clause de déplacement occasionnelle est une disposition insérée dans un contrat de travail qui prévoit que le salarié peut être amené à se déplacer ponctuellement dans un cadre professionnel.
Une clause de déplacement occasionnel – à ne pas confondre avec une clause de mobilité – est valable et peut s’imposer au salarié si elle respecte plusieurs conditions fixées par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation est venue admettre qu’un déplacement en dehors du secteur géographique où le salarié travaille habituellement (ou du champ fixé par une clause de mobilité) peut lui être imposé sous réserve d’une quadruple condition :
- le déplacement doit s’inscrire dans le cadre habituel des activités du salarié, dont les fonctions impliquent, par elles-mêmes, une certaine mobilité géographique ;
- la mission doit être justifiée par l’intérêt de l’entreprise ;
- le déplacement doit être occasionnel ou temporaire ;
- et le salarié doit être informé au préalable, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible.
Le déplacement occasionnel qui respecte ces 4 conditions ne modifie pas le contrat de travail, le refus du salarié l’expose à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
La Cour de cassation admet aussi qu’un déplacement occasionnel peut être imposé au salarié en cas de circonstances exceptionnelles, s’il est motivé par l’intérêt de l’entreprise et que la condition d’information préalable du salarié mentionnée ci-dessus est respectée (Cass. soc. 3-2-2010 n° 08-41.412).
Dans ce contexte, le principal intérêt de la clause litigieuse est de participer à la définition de ce que le déplacement s’inscrit dans le cadre habituel de l’activité du salarié.
La Cour de cassation, s’appuyant sur les articles 1103 et 1104 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail, relatifs à la force obligatoire du contrat, censure la décision de la cour d’appel.
Dès lors que le contrat de travail stipulait expressément que le salarié s’engageait à effectuer tout déplacement entrant dans ses fonctions, et que le déplacement qu’il a refusé s’inscrivait dans le cadre habituel de son activité, le déplacement en cause ne modifiait pas son contrat de travail.
Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de déterminer dans quelle mesure ce déplacement était justifié par l’intérêt de l’entreprise et de vérifier que le salarié a été prévenu dans un délai raisonnable et informé de la durée prévisible de la mission. Si tel était le cas, le refus opposé à l’employeur serait fautif.
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2025 : https://urls.fr/Rn3_cE
Elections professionnelles : des précisions sur le point de départ du délai pour les contester
La contestation des élections professionnelles, pour défaut de prise en compte d’une candidature syndicale et absence d’organisation du 1er tour, doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la publication du procès-verbal de carence du 1er tour.
Le contentieux des élections professionnelles doit respecter des délais très brefs. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, l’article R.2314-24 du Code du travail impose d’agir dans les 15 jours suivant cette élection.
Dans cette affaire jugée par la Cour de cassation le 22 janvier 2025, un protocole d’accord préélectoral (PAP) est signé en vue des élections professionnelles. Ce PAP, qui n’a pas été contesté, fixe une date limite de dépôt des candidatures mais sans plus de précisions quant à l’horaire exact. Or, un syndicat dépose une liste le dernier jour dans la soirée. L’employeur décide de ne pas la retenir et considère qu’il n’y a aucun candidat au 1er tour. Il établit un procès-verbal de carence pour ce tour des élections, puis organise le second tour.
Le syndicat qui a vu sa candidature rejetée décide alors de contester les élections avant même le second tour. Les juges du fond déclarent l’action du syndicat recevable et annulent les élections.
L’employeur décide de se pourvoir en cassation car selon lui le syndicat qui n’a pas contesté le PAP ne pouvait pas agir en annulation des élections avant le second tour. En effet, les élections peuvent être contestées en amont uniquement si le PAP fait lui-même l’objet d’une demande d’annulation (Cass.soc.12.05.21, n°19-23.428).
Un PAP non contesté et qui fixe les modalités de dépôt des candidatures permet à l’employeur d’écarter seul des candidatures tardives (Cass.soc.28.03.12, n°11-19.657).
Un syndicat qui veut contester les élections au motif que sa candidature n’a pas été retenue peut-il le faire dès le procès-verbal de carence établi pour le 1er tour ?
Cette contestation vautelle également pour le second tour ? Son action est-elle encore recevable s’il agit après le second tour ?
La contestation des élections est recevable dès la publication du procès-verbal de carence du 1er tour.
En s’appuyant sur l’article R.2314-24 du Code du travail, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de l’employeur et confirme la recevabilité de l’action du syndicat en contestation des élections avant même le second tour : « lorsqu’elle est fondée sur le défaut de prise en compte d’une candidature syndicale et l’absence d’organisation du premier tour en vue duquel la candidature litigieuse avait été déposée, la contestation n’est plus recevable au-delà d’un délai de quinze jours suivant la publication du procès-verbal de carence ».
Et s’il n’y a pas de procès-verbal de carence établi par l’employeur qui circonscrit le rejet de la candidature ?
En effet, établir un procès-verbal de carence dès le 1er tour n’est pas une obligation légale pour l’employeur. Pourtant, la Cour de cassation prévoit que c’est bien dans les 15 jours suivant le procès-verbal de carence qu’il faut contester les élections et non à la date prévue dans le PAP pour le 1er tour.
Par ailleurs, la Cour de cassation ajoute que la contestation pour le 1er tour peut permettre de contester également le second tour « il en résulte que celui qui saisit le tribunal judiciaire d’une telle contestation est recevable à demander, dans la même requête, l’annulation des élections à venir en conséquence de l’organisation contestée d’un second tour, sans avoir à réitérer cette demande dans le délai de quinze jours suivant les élections ».
La Cour de cassation précise que l’action en justice ne sera alors plus recevable car jugée trop tardive « si le syndicat avait exercé son recours dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats du second tour, il aurait pu se voir opposer la tardiveté de sa contestation ».
Consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2025 : https://urls.fr/JpdOHQ
